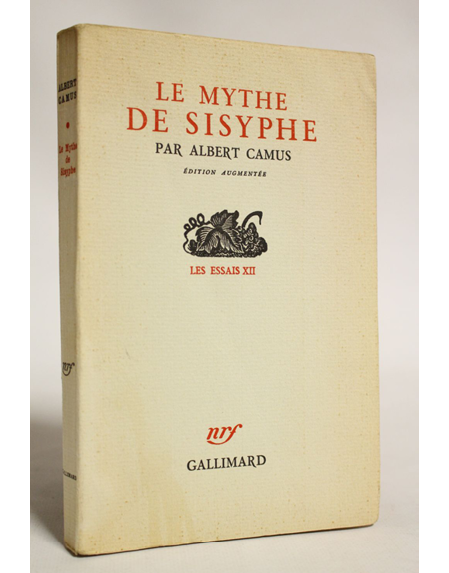
Figure 1 : « Le myhte de Sisyphe », essai datant de 1942 de Albert Camus
DN-MADe MENTION GRAPHISME
Design éditorial supports multiples
Lycée Argouges, Grenoble
Mémoire DN-MADe
Année 2023-2024
Paradoxe d’Identité : Redéfinir le Racisme par l’Absurde
Comment l’absurde permet-il de révéler les mécanismes et les effets des stéréotypes raciaux ?
Mahé MNEMONIDE
Sommaire
1. Analyse de l’absurde dans les moyens de dénonciation
1.a. Origine de l’absurde et son approche philosophique
1.b. Édifier l’absurde : ses fondations et sa construction
2. L’expérience des personnes opprimées
2.a. Témoignages et réalités d’un vécu
2.b. Moyens de dénonciation utilisés pour déconstruire les préjugés raciaux
2.c. Réalité de changements sociaux
3. La cohérence entre les deux mondes
3.a. Évaluation de la pertinence de l’absurde pour sensibiliser à l’oppression raciale
3.b. Concordance entre les représentations de l’absurde et le racisme vécu
3.c. Identification des limites et des vecteurs de changement social
« Si l’on était à l’époque de l’esclavage je t’aurais achetée »
J’ai ri. Comme j’avais déjà ri avant. Car, comme toujours, que répondre à cela ? Face à des paroles si dures et soudaines, et pourtant si familières, comment ne pas rester interdit ? Vivre dans la peau d’une personne racisée c’est ça.
Exister tout en suscitant haine, violence, moqueries, et être reléguée à un simple objet, presque grotesque, dont l’identité est sans cesse remis en question. Devoir dissimuler ses blessures sous couvert d’humour.
Confrontée au racisme, je me suis sentie vulnérable et désarçonnée dans mon rapport à la réalité et aux autres, comme plongée dans une brèche d’incertitude totale. Cela ne faisait pas sens pour moi, qu’une idéologie aussi aberrante puisse diriger mes interactions avec le monde.
Cette analyse plonge dans l’essence même de cet étrange paradoxe : comment l’absurde se révèle être un outil puissant pour révéler les rouages complexes des stéréotypes raciaux, influant notre perception de l’autre.
Soit comment l’absurde, loin d’être un simple artifice, offre une lueur pénétrante dans les profondeurs de nos représentations collectives, suscitant une réflexion essentielle sur les dynamiques sociales et culturelles de notre époque.
L’absurde est un concept désignant le caractère déraisonnable, illogique ou contradictoire de la réalité, de la pensée ou de l’existence humaine. Son utilisation varie au fil des siècles, de moyen d’expression artistique, à critique sociale ou encore résistance politique.
En tant qu’outil de dénonciation on peut questionner l’absurde sur son impact réel. Permet-il de révéler les mécanismes et les effets des stéréotypes raciaux de manière efficace ?
Cette analyse se propose d’explorer tout d’abord l’origine de l’absurde et comment celui-ci se construit. Quels sont les mécanismes permettant de rompre avec la réalité, remettant en question les normes sociales établies ?
Ensuite, nous examinerons le racisme à travers les expériences des personnes racisées, comment il se manifeste dans leur quotidien et comment ces communautés parviennent à sensibiliser sur les enjeux de leur vécu, entraînant des changements sociaux.
Enfin, nous analyserons si l’absurde est un moyen efficace de dénoncer les discriminations raciales et la nécessité de s’appuyer sur le vécu des personnes racisées. Nous explorerons aussi les limites à respecter pour ne pas desservir la cause.
The complex connection between the concept of absurdity and the manifestation of racial stereotypes constitutes the core of an existential question. How does the absurd serve as a vehicle to illuminate the inner workings and repercussions of racial stereotypes ?
The Absurd movement, challenged traditional views on human existence and explore the meaninglessness of life in an indifferent universe. However, it finds a place within criticism thanks to these effective mechanisms.
Racism relies on unfounded and irrational beliefs in the superiority or inferiority of certain racial groups solely based on their ethnicity or skin color. By analyzing narratives, cultural representations, and societal constructs, this thesis discern patterns and dynamics within racism.
Furthermore, this thesis explores the implications of absurdity in the perception and internalization of racial stereotypes. It investigate how humor, satire, and surrealism can either challenge or reinforced these preconceived notions.
L’absurde, du latin absurdus (« discordant, absurde »), en tant que concept philo- sophique et artistique, trouve ses racines dans les questionnements existentiels sur la condition humaine. Ce concept se défini comme ce « qui est manifestement et immédiatement senti comme contraire à la raison au sens commun ».
Dès le XIXe siècle, les philosophes existentialistes comme Kierkegaard ou Nietzsche ont remis en cause les fondements de la raison et de la logique. Cependant, c’est au XXe siècle que l’absurde a trouvé une expression intense à travers deux mouvements majeurs. Le dadaïsme et le surréalisme sont deux courants artistiques et intellectuels qui ont émergés en réaction à la Première Guerre mondiale et à la crise des valeurs qu’elle a engendrée.
Le dadaïsme, né en 1916 à Zurich, se caractérise par une remise en cause radicale des conventions et des contraintes esthétiques, sociales et morales . Il utilise la dérision, le nihilisme, le collage, le photomontage et les objets manufacturés pour créer des œuvres provocatrices et absurdes, qui défient la logique et le sens commun. Parmi les principaux représentants du dadaïsme, on peut citer Tristan Tzara, Marcel Duchamp, Raoul Hausmann ou encore Jacques Vaché .
Le surréalisme, quant à lui, apparaît en 1924 à Paris, sous l’impulsion d’André Breton, qui publie le premier Manifeste du surréalisme. Il se distingue du dadaïsme par son intérêt pour l’exploration de l’inconscient, de l’onirique, du merveilleux et du hasard. Il utilise des techniques comme l’écriture automatique, le cadavre exquis, le rêve éveillé ou encore le collage pour libérer l’imagination et la créativité, en dépassant les limites de la raison et de la morale . Parmi les principaux représentants du surréalisme, on peut citer Louis Aragon, Paul Éluard, Salvador Dali, René Magritte...
Le dadaïsme et le surréalisme ont en commun de remettre en question les normes et les codes de l’art traditionnel, et de proposer une vision du monde différente, fondée sur l’absurde, le non-sens, le rire et la liberté. Ils ont ainsi exercé une influence considérable sur l’art et la littérature du XXe siècle, et ont ouvert la voie à d’autres mouvements comme l’existentialisme, le théâtre de l’absurde ou encore le pop art.
L’émergence de l’absurde est particulièrement marquée dans la philosophie et la littérature. Albert Camus, un des pionnier du terme de l’absurde, développe l’idée de l’absurdité de la condition humaine à travers un mythe grec dans son essai « Le Mythe de Sisyphe » (Figure 1). Sisyphe est condamné à rouler éternellement un rocher jusqu’au sommet d’une montagne, pour le voir sans cesse redescendre. Malgré cela, il persévère, bien qu’il soit conscient que son destin se heurte à une punition irrationnelle . Pour Camus, Sisyphe incarne la répétition infinie et dépourvue de sens. Il expose la lutte incessante de l’homme pour trouver un sens à un monde indifférent et chaotique. L’absurdité réside dans le fait de persévérer malgré la futilité de l’effort. L’auteur met ainsi en lumière la confrontation entre l’aspiration humaine à trouver du sens et la réalité indifférente et chaotique du monde.
Cette quête de sens peut être retrouvée dans la pièce de théâtre en deux actes « En attendant Godot » (Figure 2) de Samuel Beckett. Publiée en 1952, elle met en scène les personnages de Vladimir et Estragon, attendant un certain Godot sans réellement savoir qui il est, pourquoi ils l’attendent, ni même s’il viendra. Le temps est une dimension essentielle de l’absurde dans la pièce. Les protagonistes sont dans l’ignorance quand à la suite des évènements, ce qui souligne l’éternelle attente sans dénouement.
Ce temps suspendu souligne l’inutilité de leur quête. De plus, le dialogue est souvent non linéaire, répétitif et dénué de sens concret. Les échanges entre les personnages sont marqués par des jeux de mots, des non-sens, des quiproquos et des répétitions qui désorientent le spectateur . Cette pièce remet en question les certitudes, les attentes et les structures traditionnelles du théâtre, offrant au public une expérience théâtrale déconcertante et profondément réflexive, tout en interrogeant sur le sens de l’existence Humaine.
La construction de l’absurde repose sur la rupture avec la logique conventionnelle pour susciter la réflexion et remettre en cause les normes établies. Comme vu précédemment, les artistes, écrivains et les cinéastes utilisent des situations inattendues, des juxtapositions illogiques et des représentations déformées de la réalité pour attirer l’attention sur les absurdités de la société contemporaine.
C’est ce que l’on peut constater dans cette analyse de l’absurde par Pierre Dac qui nous dépeint l’absurde comme une arme politique incontestable . Pierre Dac est un maître de l’humour absurde des années 1930. Il utilise l’absurde comme une arme politique pour dénoncer les travers de la société, les mensonges des dirigeants, ou les horreurs de la guerre . Il invente ainsi des mots, des expressions ou des concepts loufoques, comme le Schmilblick, le biglotron, ou la confiture de nouilles. Il popularise également l’expression « loufoque », formée à la façon du louchébem, l’argot des bouchers. Il est aussi l’auteur de nombreuses citations, aphorismes et paradoxes, qui révèlent son sens de la dérision, de la contradiction et de l’antiphrase . Par exemple : « Parler pour ne rien dire et ne rien dire pour parler sont les deux principes majeurs et rigoureux de tous ceux qui feraient mieux de la fermer avant de l’ouvrir ».
Pierre Dac est également un résistant, qui s’engage dans la lutte contre l’occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Il rejoint Londres en 1943, où il anime l’émission « Les Français parlent aux Français » sur Radio Londres. Il y diffuse des messages codés, des informations, mais aussi des sketchs, des chansons et des slogans humoristiques, qui visent à ridiculiser le régime de Vichy et à soutenir le moral des Français. Par exemple : « Radio Paris ment, Radio Paris est allemand ». Il collabore aussi avec le général de Gaulle, qu’il surnomme affectueusement « le Grand Duduche » . Pierre Dac est donc un humoriste engagé, qui utilise l’absurde comme un moyen de résistance, de critique et de subversion . Il est considéré comme le père spirituel de nombreux comiques, tels que Raymond Devos, Pierre Desproges, Les Monty Python ou encore Les Nuls. Il est aussi un humaniste, qui prône la tolérance, la fraternité et la paix. Il est l’auteur du célèbre slogan : « Rien n’est plus semblable à l’identique que ce qui est pareil à la même chose ».
Utiliser l’incohérence et les paradoxes permet de marquer les esprits car la logique fait partie intégrante de notre mode de fonctionnement. Sortir de ce mode de fonctionnement nous fait donc réagir. En effet, c’est lorsque les spectateurs ont une attente et que la conclusion ne suit pas ses prémisses, provoquant un décalage avec l’expectative qu’une distanciation se produit.
De plus, intervertir les rôles est un bon moyen de créer l’effet de surprise tout en pointant du doigt l’oppresseur. C’est ce qu’à fait Jean Genet dans sa pièce de théâtre subversive de 1959, « Les Nègres » (Figure 3). Celle-ci met en scène un groupe d’acteurs noirs qui interprètent des rôles stéréotypées et racistes généralement joués par des acteurs blancs . Par cette inversion des rôles, Jean Genet utilise l’absurde pour inviter les spectateurs à remettre en question les représentations raciales au théâtre . Les Noirs sont peints en blancs à la manière des « Blackfaces » qui étaient effectués à l’époque.
Le « blackface » , traduisible par « grimage en Noir », est une forme théâtrale d’origine américaine pratiquée dans le monde du spectacle où un comédien blanc incarne une caricature stéréotypée de personne noire . Cette pratique avait pour but de parodier la communauté noire en accentuant leurs traits. Par exemple : nez et lèvres grossis outrageusement, peau teinte en noir, utilisation de perruques, attribution de traits de caractères rabaissant...
Un autre exemple de détournement de références culturelles Utiliser des symboliques culturelles permet de toucher la sensibilité car ce sont des représentations familières. Le groupe féministe et activiste New-yorkais, les Guerilla Girls jouent avec ces emblèmes pour dénoncer la corruption dans le monde de l’art et le manque de diversité au sein des galeries. Elles détournent des visuels en lien avec le monde de l’art et de la culture américaine comme des statues ou des figures emblématique. Par exemple, une de leurs affiches « We sell white bread » (Figure 4), ridiculise le piédestal sur lequel sont hissés les hommes artistes blancs. Pour les Guerrilla Girls, l’exposition de seulement ce types d’artistes rendrait l’expérience superficielle et sans saveur.
Nous avons vu que l’absurde est une pratique plutôt récente dans l’histoire contemporaine éclairant des questions sociales. L’absurdité se révèle être un outil puissant pour éveiller les consciences de par sa rupture avec la logique incitant une réflexion critique et à une remise en cause des schémas préétablis.
Afin de parler de l’expérience de personnes racisées, il me paraît essentiel de donner une définition du racisme et de ce qu’il implique.
Le musée international de l’histoire de l’immigration définit le racisme comme « Une forme de discrimination fondée sur l’origine ou l’appartenance ethnique ou raciale de la victime, qu’elle soit réelle ou supposée. » L’existence même du racisme trouve ses racines dans une idéologie et un véritable système politique, affirmant l’existence de races au sein de l’espèce humaine.
Cela se caractérise par une domination s’appuyant des stéréotypes et préjugés pour porter atteinte à la dignité d’un groupe d’individus, alimentant ainsi la violence et la haine. Or, cette hiérarchisation ne semble répondre à aucun raisonnement logique.
La question de l’utilisation du vécu des personnes BIPOC1 pour créer du contenu militant et engagé est d’une importance capitale dans les domaines artistiques, médiatiques et sociaux contemporains. Avoir des espaces dédiés à l’expression des communautés marginalisées est nécessaire pour permettre la dénonciation des injustices et la sensibilisation à la réalité des minorités raciales.
Ces témoignages sont un héritage précieux et permettent de garder une trace d’événements historiques menacés d’être oubliés ou effacés. C’est un véritable travail d’entretien des mémoires que de rechercher cette parole dans les communautés qui sont souvent mises sous silence car considérées comme inférieures.
Nous pouvons prendre pour exemple l’émission radio LSD de France Culture, et plus précisément la série « La marche de 83 : histoire d’une égalité manquée » (Figure 5) qui montre l’importance d’entretenir la mémoire.
Durant les années 1970-1980, on assiste à une immigration massive de Nord-Africain. Le climat est alors déjà tendu entre la population française et les communautés racisées. Mais ce qui va enclencher cette violence, c’est le meurtre d’un chauffeur français par un Algérien en 1972, qui enflamme l’opinion publique. Les années suivantes connaissent alors une montée en puissance du sentiment d’insécurité, entraînant une augmentation massive des crimes racistes par des particuliers sous couvert de « légitime défense ». Ce qu’on appellera alors les « ratonnades2 » sont peu médiatisées et non répertoriées.
Or, en 1973, un événement marquant va renverser la situation. Le meurtre de Wahid Hachichi par un policier va politiser les crimes racistes et sécuritaires. Les collectifs pré-existants s’emparent de l’affaire et organisent des manifestations et rassemblements aux côtés de la famille Hachichi. L’affaire entraînera alors l’engagement d’intellectuels tel que Jean-Pierre Foucault.
Cependant, suites à ces nombreux incidents, l’Algérie interroge la France sur sa responsabilité. Le ministère de l’intérieur va alors demander aux différentes préfectures de faire remonter les incidents impliquant des Nords-Africains.
Pour sauvegarder son image et entretenir de bonnes relations avec l’Algérie, l’administration française falsifie les rapports afin d’occulter le caractère raciste des agressions témoignées par les travailleurs immigrés.
La prise en compte du vécu des personnes racisées est essentielle car cela permet de reconnaître et de documenter les expériences souvent marginalisées et étouffées dans l’histoire officielle. Cela contribue à sensibiliser sur les injustices vécues, à lutter contre l’oubli des événements historiques majeurs, tout en éclairant les débats contemporains sur le racisme et la discrimination. Mais aussi de commémorer et d’honorer les victimes de ces violences. En écoutant et en valorisant ces récits, la société peut avancer vers une justice sociale et une reconnaissance collective des diversités d’expériences.
Afin de pouvoir partager ces expériences, il est important que des individus prennent la parole et utilisent différents moyens de diffusions. Avoir des figures emblématiques permet de pouvoir se référer à un modèle à suivre dans une recherche de réconfort face à un vécu.
Dans la lutte contre le racisme est Emory Douglas, ministre de la Culture et artiste révolutionnaire du Black Panther Party3, est une icône importante. Il a supervisé la direction artistique et la production de « The Black Panther » (Figure 6), le journal officiel du parti, de 1967 jusqu’à sa dissolution au début des années 1980.
L’artiste se démarque par un style graphique frappant et unique. Dans une interview accordée à l’occasion de la réception d’une médaille de l’AIGA en 2015 , il a souligné l’importance de l’art politique et de l’utilisation de l’image pour atteindre les communautés peu alphabétisées.
Son travail appartenant à une culture de résistance a servi à informer les Noirs des problèmes de leurs propres communautés. En utilisant des mises en scènes grotesques, Emory met en lumière l’absurde de ces situations qui sont finalement choquantes et révoltantes. Il dénonce une différence de traitement et une déshumanisation des personnes racisées.
Malgré le fait que les Black Panthers ne soient pas les seuls à défendre les communautés noires, ils sont les premiers à en faire une cause nationale. Ils proposent des programmes sociaux radicaux à destination des communautés afro-américaines pour lutter contre la discrimination raciale et défendre leurs droits civiques.
D’autres graphistes se sont penchés sur le manque de représentation des personnes de couleurs et sur la raison de cette absence, notamment dans le design graphique et les arts. En 1987, Cheryl D. Holmes Miller, a rédigé un article nommé « Les designers noirs : Absents au combat » pour le magazine Print. Dans cet article, elle décrit la manière dont la vision euro-centrée dans le design graphique impact la manière dont les personnes racisées expriment leur créativité, comment leurs travaux sont perçus et parfois invalidés. Dans son interview en novembre 2021 pour le magazine indépendant Sightlines, elle souligne l’influence de la culture dominante, mettant en lumière le fait que l’histoire et l’enseignement sont encore souvent contrôlés par des hommes blancs : « La grille Helvetica, alignée à gauche, justifiée à droite, laissant de l’espace blanc tout autour de la page, représentait l’esthétique de l’oppresseur. Si vous étiez un designer noir à l’époque et que vous souhaitiez être employé par l’un des studios élites établis, eh bien, bonne chance. Le système de grille suisse et Helvetica étaient l’évangile du design des hommes blancs. »
En effet, notre cerveau tend à associer le familier, donc ce à quoi nous sommes exposés continuellement, à ce qui est « bon ». La représentation dominante des designers blancs forme alors notre perception du « bon » design.
Afin de changer cette dynamique en faveur d’une représentation plus équitable et diversifiée, l’idée est d’étudier la manière dont le design graphique est abordé autour du monde. Pour élargir sa perspective, Cheryl Miller recommande de rechercher activement et d’inclure délibérément le travail des designers BIPOC dans son référentiel mental et visuel. Elle insiste sur l’importance de la saturation visuelle avec des images diverses pour développer une appréciation plus large du design. La sous-représentation historique du travail des designers noirs peut être aussi compensée par la mise à dispositions de ressources accessibles à tous. Les bases de données de créatifs BIPOC et des conférences abordant ces thématiques offrent des moyens d’accéder et de mettre en valeur ce travail souvent négligé. Enfin, l’auteur insiste sur la nécessité pour l’industrie de reconnaître et d’intégrer cette diversité.
Certaines figures incarnent cette réappropriation, par la musique, qui est un moyen puissant de faire passer des messages en touchant à l’émotionnel. Beyoncé a été cette représentation pour des générations. Née en 1981 à Houston Beyoncé Giselle Knowles est l’une des chanteuses les plus reconnues au monde et aux États-Unis. À la suite d’actes de racismes et de brutalité policière à l’encontre du peuple afro-américain, Beyoncé a assumé un rôle politique et activiste.
Dans cette idée de représentation, son clip « Formation » (Figure 7) sorti en 2016, est un bon exemple d’une ode de la culture afro-américaine. En jouant sur les mots et le double-sens, Beyoncé déconstruit les stéréotypes sur les communautés noires. Elle utilise le vocabulaire de l’argot afro-américain utilisé initialement pour discriminer la communauté afin de renverser la dynamique de pouvoir entre les noirs et les blancs. Avec cette volonté de prôner le « Black Love 4 » et redonner son pouvoir au peuple noir, le terme « Formation » dans cette chanson symbolise la résistance et le communautarisme.
Comme mentionné précédemment, face à la prédominance d’un récit national, les témoignages se présentent comme un puissant moyen de préserver de l’oubli les expériences des populations issues de l’immigration postcoloniale. Avec autant de canaux de distributions différents, on peut se demander ce qu’il en est réellement des changements sociaux.
Aya Cissoko, autrice, comédienne et ancienne championne de boxe, évoque une évolution sociale lente dans le podcast « Kiffe ta race » (Figure 8) de 2022. Intitulé « Autobiographie : transmettre soi-même l’Histoire », cet épisode aborde la thématique des conséquences du racisme institutionnel et de l’importance de la transmission de la mémoire. A travers ses enquêtes, elle a pu observer qu’il n’y avait que très peu de changements dans la société. Elle soulève que « des enfants vivent les mêmes expériences que moi, 30 ans après ».
Finalement, le racisme perdure. D’abord des éléments de langage reviennent. Elle fait un parallèle entre le terme « menace bolchéviste » et « islamo-gauchiste ». Ensuite, les mécanismes sont constants. Elle souligne que les lois votées aujourd’hui renforcent la stigmatisation et l’exclusion des personnes musulmanes, évoquant le traitement réservé à la communauté juive durant les années 1930.
En définitive elle cite l’écrivain guinéen Djibril Tamsir Niane qui disait « Le monde est vieux mais l’avenir sort du passé » soulignant que pour enclencher des changements, puiser dans le passé est nécessaire pour un avenir nouveau.
Pour que des changements sociaux réels adviennent, cela requiert des actions à deux niveaux.
D’abord que les opprimés continuent à s’exprimer. Dorothy E. Hayes est une graphiste qui a participé à mettre en lumière 49 créatifs noirs lors d’une exposition de 1970. Ceux-ci sont souvent absents des publications et de la scène publique, malgré leur contribution à l’industrie. Pour décoloniser le design, cette artiste a souhaité élargir la perspective visuelle mondiale en leur permettant d’avoir une place légitime dans les conversations artistiques.
« African Design Matters5 » est un collectif que l’on peut trouver sur Instagram. Leur objectif est le suivant : professionnaliser l’artisanat et l’esthétique du design panafricain. Ils créent de magnifiques œuvres en utilisant toute la diversité de la palette africaine, ses couleurs et d’autres éléments naturels. Ils développent des polices de caractères, des designs et des systèmes de communication.
On assiste grâce aux réseaux sociaux à la naissance de mouvements permettant l’entraide et favorisant la visibilité des communautés racisées. Par exemple le Black Lives Matter (BLM)6 est mouvement politique américain qui lutte contre le racisme systémique, notamment dans le système judiciaire, envers les personnes noires. Celui-ci est lancé en 2013 après l’acquittement du meurtrier de Trayvon Martin, un adolescent noir tué par un vigile blanc.
Héritage des Black Panthers, de Malcolm X et de Martin Luther King, le mouvement a connu un regain d’activité et de visibilité en 2020. Après le meurtre de George Floyd, un homme noir asphyxié par un policier blanc à Minneapolis, les images de l’agression ainsi que le hashtag « #BlackLivesMatter » prennent une ampleur considérable sur la scène national. Cette large médiatisation a contribué à mobiliser des millions de personnes dans le monde, de toutes les races, pour exiger des changements dans les politiques, les lois et les institutions.
En deuxième lieu, les colonisateurs doivent s’emparer de la question et mettre en place des changements. Sans quoi, aucun progrès significatif ne pourra être réalisé.
Pour susciter la prise de conscience chez l’oppresseur, il faut que celui ci accède à la réalité d’un vécu qui n’est pas le sien pour éprouver de la sympathie et créer une rupture dans le cycle de la violence.
Cela passe par différents canaux, de l’accès à l’information à l’accès à la représentation. Avoir accès à une représentation diversifiée permet une meilleure compréhension et tolérance.
Quand cela ne suffit pas, l’utilisation de l’absurde peut être le déclencheur d’une prise de conscience. Le rire peut remettre en question les idées préconçues.
Par exemple l’humoriste britannique Sacha Baron Cohen, a créé dans les années 1990, plusieurs personnages absurdes pour dénoncer le racisme. Il a piégé des personnalités ou des anonymes en les confrontant à des situations choquantes ou grotesques. En mettant les personnes blanches face à leurs propres stéréotypes, il a mis en lumière le ridicule de leurs préjugés.
L’utilisation de l’absurde dans la dénonciation des systèmes raciaux est cependant une stratégie complexe et nuancée.
D’une part, elle peut être un moyen efficace de mettre en évidence l’irrationalité et l’injustice de ces systèmes. La logique des spectateurs est trompée ce qui peut reproduire l’effet de surprise provoqué par les agressions liées au racisme.
Par exemple, l’agence de designer Boston & Boston, a su utiliser l’effet de surprise à leurs avantage. Archie Boston Jr. et son frère Brads publient en 1967, une de leur affiche promotionnelle marquante « For Sale » (Figure 9).
Celle-ci met en scène les deux frères portant des pancartes « À vendre », associées à des statistiques physiques et des remarques ironiques. Cette affiche est une référence directe à la traite négrière et la manière dont les esclaves Noirs était catégorisés et vendus comme du bétail. De plus, ils jouent avec l’image du noir stéréotypé avec la phrase « Voleront des expositions d’art s’ils sont libérés ».
Sorties au cœur du mouvement des droits civiques, ces affiches évoquaient des événements à la fois traumatisants et propres à l’expérience afro-américaine. Cette tactique leur aura permis d’ attirer l’attention sur leur travail tout en suscitant des discussions sur l’inclusivité dans l’industrie du design.
Le duo dénonce aussi une industrie dans laquelle ils se sentent invibilisés et ne semblent êtres remarqués qu’en prenant le rôle de l’oppresseur. En poussant la parodie à l’extrême cela permet de mettre en avant l’absurdité des discriminations raciales car la créativité n’est pas une question de race.
Archie Boston Jr. a exprimée lors d’une conférence au Hoffmitz Milken Center for Typography en octobre 2020 : « Tout d’abord, je crois qu’il faut attirer l’attention du spectateur, que ce soit de manière positive ou négative. J’essaie toujours de transformer à terme le négatif en positif. »
D’autre part, il y a le risque que l’utilisation de l’absurde puisse involontairement renforcer les stéréotypes raciaux qu’elle cherche à dénoncer. Par exemple, si une œuvre d’art utilise l’absurde pour caricaturer un stéréotype racial, le public peut ne pas reconnaître l’intention satirique de l’artiste et prendre la caricature au pied de la lettre. De plus, même lorsque l’intention satirique est reconnue, la répétition de stéréotypes raciaux peut contribuer à leur perpétuation.
Certains humoristes ont été censuré à un certain point de leur carrière. C’est le cas du vidéaste et humoriste Norman Thavaud par exemple. Accusé de racisme et misogynie pour un sketch en décembre 2020, l’humoriste aurait en effet l’utilisé le prénom « Fatoumata » pour moquer le dernier James Bond dans lequel l’agent secret britannique 007 est interprété par l’actrice Lashana Lynch, qui est une femme noire. Durant son sketch, Norman Thavaud aurait notamment dit : « My name is Bond, Fatoumata Bond. Non ça va pas du tout, je suis pas d’accord ».
La chanteuse noire Yzeult et le compte Instagram « Décolonisons-nous », dont le but est de « déconstruire l’héritage postcolonial de l’inconscient collectif », dénoncent le caractère discriminant et humiliant de la blague de l’humoriste. Le compte Instagram, soutient que l’utilisation de ce prénom dans ce contexte précis ne fait que renforcer les stéréotypes qui l’entoure.
Norman Thavaud s’est défendu en précisant que sa blague n’avait nullement pour but de blesser une communauté mais plutôt de critiquer l’hypocrisie du cinéma américain dans sa manière de représenter la diversité. Il précise qu’il aborde souvent les thèmes liés au racisme et au privilège blanc dans ses spectacles. Il défend la sincérité de son engagement antiraciste. Face à la polémique, il s’est excusé cependant de sa maladresse.
L’humoriste participe finalement à maintenir un prénom Africain en tant qu’objet de stigmatisation, de rejet et de moquerie. En effet, l’imaginaire collectif concernant l’africain stéréotypé est encore bien ancré en France.
Il est donc crucial que les artistes qui utilisent l’absurde pour dénoncer l’oppression raciale soient conscients de ces nuances et fassent preuve de prudence et de sensibilité dans leur travail. Ils doivent s’efforcer de communiquer clairement leur intention à leur public et de créer des œuvres qui provoquent une réflexion critique plutôt que de renforcer les préjugés existants.
L’idée est d’assurer la concordance entre les différentes expressions de l’absurde et les expériences réelles de racisme. Cela implique que les représentations de l’absurdité, souvent utilisées pour mettre en lumière les aspects illogiques du racisme, reflètent fidèlement les expériences vécues de discrimination raciale.
Le racisme peut amener un sentiment d’étrangeté, de décalage ou de contradiction entre les aspirations humaines et la réalité du monde. Les personnes qui subissent le racisme peuvent éprouver un sentiment d’incompréhension, d’isolement ou de désespoir, face à un monde qui leur apparaît hostile, injuste ou dénué de sens. Elles peuvent alors adopter des attitudes de révolte, de résignation ou de fuite, qui sont autant de réponses possibles à l’absurde.
Adrian Piper, une artiste afro-américain, introduit cette question de la race et du genre en utilisant l’absurde et son vécu de femme racisée. Avec son ensemble de sept performances de rue conceptuelles nommés « Catalysis », l’artiste performera de 1970 à 1973 dans les rues de New-York City. Deux de ses performances marquantes sont « Wet Paint » (Figure 10) où elle arbore un panneau avec écrit « peinture fraîche » et « Mythic Being » où elle se déguise en ouvrier métisse en répétant des mantras.
Le titre de la série trouve son origine dans la définition : « catalyse » est un terme scientifique qui désigne l’accélération d’une réaction chimique par un catalyseur. Dans l’œuvre de Piper, cette définition prend vie parce que l’artiste utilise un comportement absurde pour voir à quelle vitesse elle peut déclencher une réaction chez ses spectateurs, surtout en tant que femme de couleur au début des années 1970 en Amérique.
En outre, le racisme et la violence qui en découlent rendent certaines expériences de vies sensibles. Utiliser l’absurde deviens alors un moyen d’aborder ces sujets en prenant de la distance.
On joue avec le rire dans le but de soulever des questions. Dans le but de confronter le public de manière modéré. En effet, un message sera davantage bien accueilli s’il est présenté, non pas comme une confrontation directe susceptible de rendre l’autre partie réticente, mais plutôt comme un point de vue auquel elle peut s’identifier.
La sensibilité des personnes diffèrent en fonction de leur vécu, de leur environnements et d’autres facteurs ce qui peut impacter la manière dont le message est reçu. L’humour permet de mettre de la distance, mais peut aussi renforcer le sentiment de ne pas être entendu, cru et vu.
Dans un premier temps, nous avons vu que l’absurde permettait de mettre en lumière le non-sens du racisme. Il peut, en ce sens, permettre des prises de consciences et l’émancipation des artistes noirs qui arrivent à s’en saisir.
Yasmina Atta, artiste nigérienne, enfreint les codes afin de créer des créations étranges et improbables dans une volonté de questionner l’appartenance culturelle.
Elle fusionne l’esthétique cinématographique de Nollywood7 dans sa collection « Kosmos en Bleu » (Figure 11). Inspirée par le folklore africain, l’architecture Hausa, les anime japonais et les films rétrofuturistes des années 1960, elle explore l’identité post-coloniale africaine. En s’inspirant du réalisateur sénégalais Djibril Diop Mambéty, connu pour ses représentations oniriques de la société africaine des années 1960 et 70, elle mêle mysticisme, afro-futurisme8 et une fusion entre cultures occidentale et africaine.
En plus de trouver son inspiration dans différentes culture drastiquement différentes, Yasmina Atta mélange aussi les matériaux ainsi que les techniques. Cela enrichis les aspects visuels et sensoriels de ses créations, mais en plus, cela encourage un dialogue interculturel en mettant en valeur les similitudes et les différences entre les cultures, favorisant ainsi la compréhension et l’appréciation mutuelle.
Ce mélange d’influences, forment une nouvelle tendance, se proposant comme une réinvention du concept d’identité. Par le bais d’un assemblement à première vue illogique, ses tenues deviennent finalement un symbole de syncrétisme culturel.
Dans un autre temps l’utilisation de l’absurde peut renforcer le racisme systémique s’il n’atteint pas sa cible efficacement.
Certains remettent en question la légitimité des personnes non-racisées ou des institutions à exploiter ces récits pour des gains personnels ou politiques, craignant une récupération opportuniste des expériences de marginalisation.
C’est le cas de l’agence de design graphique Quiet Storm, qui lance en 2020 la campagne publicitaire de lutte contre le racisme « Create Not Hate » (Figure 12). Une des affiches représente de manière très simplifié un peigne planté dans une coiffure affro. Le texte dit « Ils voient une arme, nous voyons un peigne », en référence à de nombreux policiers américains ayant abattu des afro-américains pensant que leur brosse était en fait une arme. L’illustration dénonce la facilité avec laquelle la police aux États-Unis écarte l’idée de « présomption d’innocence » et à la violence plus facilement lorsqu’il s’agit d’individus noirs.
Cette campagne visait à intégrer davantage de jeunes issus de minorités ethniques dans les industries créatives. Cependant, en allant sur le site de l’agence Quiet Storm, on constate que la majorité des graphistes sont blancs. Seulement 4 employés et partenaires sur 20 sont racisés dont seulement 2 faisant partie de la communauté noire. Les seuls noirs visibles sont les mannequins embauchés pour la publicité. Cela pose question sur la cohérence entre les messages de diversité et de tolérance diffusés et la réalité dans le milieu.
Il est également crucial de reconnaître la diversité des expériences au sein des communautés racisées. Une représentation monolithique du vécu des personnes racisées peut conduire à une vision simpliste et réductrice des enjeux complexes auxquels elles font face.
L’utilisation de l’absurde, se heurte finalement à une histoire. La journaliste Aphelandra Siassia me l’a confié lors de notre interview : « Quand on est artistes, ou créateurs racisée, à l’heure d’aujourd’hui, je pense qu’on est vraiment dans une scène qui essaye de porter un discours fort, qui essaye de visibiliser des paroles, des positionnement. Et du coup, avec ces enjeux-là, je pense qu’il est difficile encore aujourd’hui de rire pleinement de cette condition. »
Cela pose question sur comment s’émanciper finalement, de cette identité, de cette violence pour pouvoir finalement l’aborder avec légèreté.
En résumé, bien que l’absurde puisse offrir une certaine prise de contrôle sur la représentation en déviant celle-ci, les douleurs passées demeurent trop profondes pour être totalement tournées en dérision.
L’absurde, une fois confronté à notre raisonnement logique, peut engendrer selon Albert Camus, la révolte, la soif d’émancipation ou bien la passion. Des réactions similaires en somme à celles que le racisme suscite chez ceux qui y sont confrontés. En considérant le racisme comme un enjeu social majeur et l’utilisation de l’absurde comme moyen de dénonciation marquant, on peut se demander si celui-ci peut être au service de la dénonciation de la race.
Considérant, la manière dont l’absurde capte notre attention, son utilisation dans des contextes de dénonciation semble justifié. Le non-sens choque, pose question et offre de nouvelles perspectives. Mais son application peut cependant se montrer délicate et finalement nuire à la cause, s’il n’est pas employé avec précaution. Comme aborder précédemment, l’absurde semble être un vecteur et un moyen d’émancipation efficace au premier abord. Celui-ci permet de transmettre le sentiment d’absurdité ressentit face aux interactions racistes soudaines et violentes. Il permet une réappropriation de certains codes de ses communautés et ainsi initier des mouvements collectif d’émancipation. Cependant, pour coïncider avec l’expérience des personnes racisées, respecter leur témoignages et prendre appui sur leur vécu est primordiale pour prévenir un renforcement des préjugés et de l’imaginaire collectif. Faire cohérence entre les représentations et identifier les limites à respecter permettrait de dénoncer efficacement les discriminations raciales tout en offrant un espace d’expression à ces mêmes communautés.
En tant que designer sociale, mon intérêt se porte sur comment représenter de manière visuelle l’absurde afin que ce message soit au service de la dénonciation raciale efficacement. La difficulté que j’ai pu rencontrer lors de l’écriture de cette note de synthèse est le manque de représentation à disposition. Cela me semble donc nécessaire de trouver un moyen de mettre en avant le vécu des créateurs racisés au travers une installation confrontant les spectateurs aux agressions quotidiennes vécu par ces communautés. Cette installation proposerait des visuelles et expériences auditives soudaines, sans sens-logique et parfois surstimulantes pour imiter les micro-agressions découlant de la hiérarchisation raciale. En complément, un contenu informatif sera mis à disposition, à destination du tout public. L’idée est que chacun puisse s’identifier et prendre pour soi l’expérience qu’il va vivre et ce, qu’importe son origine. Cette expérimentations sera ensuite retranscrite sous forme graphique, en s’appuyant sur les retours d’expériences des spectateurs. Proposant ainsi l’absurde comme moyen de sensibilisation au racisme systémique.
L’enjeu auquel je serais confronter sera de jouer sur un double ton : informatif et absurde, afin de ne pas discréditer mon discours mais de garder le sentiment de non-sens que je ressens face au racisme. Et ce en jouant sur deux leviers, d’abord celui de dénonciation et en second temps un levier de valorisation.
Absurde / adjectif
1. Qui est contraire à la raison, au sens commun, qui est aberrant, insensé : Ce raisonnement absurde aboutit à un non-sens. Il est absurde de croire aux revenants.
2. Qui parle ou agit d’une manière déraisonnable
3. Pour les existentialistes, se dit de la condition de l’homme, qu’ils jugent dénuée de sens, de raison d’être.
Racisme / nom masculin
1. Idéologie fondée sur la croyance qu’il existe une hiérarchie entre les groupes humains, autrefois appelés « races » ; comportement inspiré par cette idéologie.
2. Figuré, par exagération. Attitude d’hostilité systématique à l’égard d’une catégorie déterminée de personnes : Racisme anti-jeunes.
Nollywoodien / nom masculin
1. Relatif au cinéma nigérian. Avec le suffixe adjectival -ien, de Nollywood, mot-valise de Nigeria et de Hollywood
Afro-futurisme / nom commun
1. Mouvement artistique émergé dans la seconde moitié du XXe siècle. Il a redéfini la culture et la notion de la « communauté noire » en mélangeant des éléments de science-fiction, d’afrocentrisme et de réalisme magique dans divers formes d’arts. Volonté d’émancipation de l’influence occidental.
Réalisme magique / nom masculin
1. Notion mise en place en 1925. Renvoie à une vision du monde spécifique par rapport aux genres et catégories importées d’Europe, comme le merveilleux, le fantastique ou les divers « réalismes ».
Syncrétisme / nom masculin
1. Système philosophique ou religieux qui tend à faire fusionner plusieurs doctrines différentes.
2. Synthèse de deux ou plusieurs traits culturels d’origine différente, donnant lieu à des formes culturelles nouvelles.
3. Système archaïque de pensée et de perception, consistant en une perception globale et confuse de différents éléments.
Ratonnade / nom féminin
1. Violences exercées contre une communauté nord-africaine en représailles à des actions attribuées à certains de ses ressortissants.
BIPOC / POC / adjectif
1. (Anglicisme) Terme général pour désigner les Noirs, Autochtones et personnes de couleur.
BlackFace / masculin ou féminin (en fonction de l’usage)
1. (Anglicisme) Fait de se maquiller en noir pour ressembler à une personne noire, pour le théâtre, ou pour des moqueries racistes.
Je voudrais tout d’abord adresser toute ma reconnaissance à l’équipe pédagogique, notamment Audrey BALLAND ainsi qu’à Jerôme BEDELET pour leur patience, les outils méthodologiques qu’ils m’ont apportés et leurs conseils.
Merci à Aphélandra Siassia et Sylvain (aka SLip) d’avoir pris le temps de partager leur expérience avec moi et pour leur témoignage qui ont contribué à nourrir ma réflexion.
Je tiens également à remercier ma famille et mes amis pour leur soutien, leurs encouragements et leur compréhension.
Enfin, je souhaite adresser mes remerciements à toutes les personnes qui ont contribué de quelque manière que ce soit à l’élaboration de cette analyse.
1 BIPOC est un acronyme anglais né aux États-Unis qui gagne en popularité dans la lutte contre le racisme. Ce terme signifie « Black, indige- nous and people of color » soir en français « Noirs, Indigènes et personnes de couleurs ».
2 Expédition punitive ou brutalités exercées contre des Maghrébins.
3 Organisation politique révolutionnaire active aux États-Unis dans les années 1960 et 1970. Fondé en 1966 en Californie par Huey Newton et Bobby Seale, ce mouvement prônait l’autodéfense des Afro-Américains contre les brutalités policières et le racisme institutionnalisé, ainsi que la lutte pour l’égalité des droits civiques.
4 Le black love est un mouvement venu des Etats-Unis et puise son origine dans les mouvements militants de la communauté afro-américaine . Il symbolise l’émancipation de cette dite communauté.
5 « Le design africain compte »
6 Traduction : Les vies Noires compte.
7 industrie cinématographique Nigérienne, qui est l’une des plus importantes au monde en termes de production de films, souvent à budgets réduits.
8 Afro-futurisme : mouvement artistique émergé dans la seconde moitié du XXe siècle. Il a redéfini la culture et la notion de la « communauté noire » en mélangeant des éléments de science-fiction, d’afrocentrisme et de réalisme magique dans divers formes d’arts. Volonté d’émancipation de l’influence occidental.